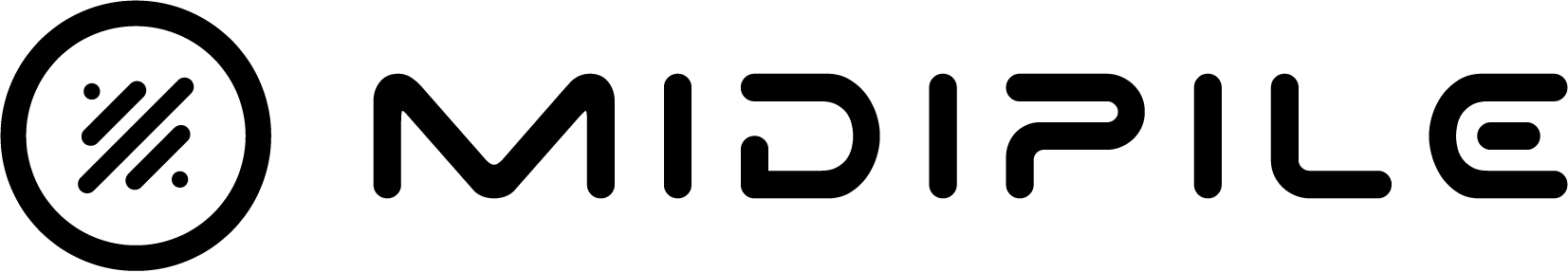Retour
L’avenir des véhicules intermédiaires
Nos actualités

Ecrit par Benoit le 09 avril 2025
L’automobile, un objet qui facilite la vie
Notre automobile chérie est un moyen de transport « magique ». Elle nous permet d’aller d’un point A à un point B sans fournir d’effort et en parfaite sécurité. Elle a l’immense avantage de pouvoir pallier l’imprévu : embarquer de la charge, ajouter des passagers, faire des détours ou rouler les jours de grandes pluies ou de grand vent.
Mais notre automobile magique c’est 1,3 tonnes à déplacer à chaque instant quand 95% de l’énergie dépensée sert à bouger le véhicule et non ses utilisateurs. Nos véhicules automobiles sont indiscutablement suboptimaux : ils sont dimensionnés pour des cas d’usages maximums et peu fréquents et conservent ces caractéristiques pour l’ensemble des cycles de roulage.
Nous sommes beaucoup à vouloir se passer de cette voiture mais nous nous retrouvons rapidement bloqués avec nos vélos ou vélos à assistance électriques : temps passé sur le vélo, sécurité dans le trafic, transpiration, intempéries, vols ou capacité d’emport. Comment je vais chercher mes enfants à l’école ou récupérer mes courses au Drive ?
Dans une vie occidentale moderne les injonctions sont nombreuses et il est compliqué, parfois héroïque d’abandonner son automobile pour un vélo. Et c’est d’autant plus vrai dans des territoires ruraux, petites et moyennes agglomérations qui concernent presque la moitié de la population Européenne.
Pourquoi ne pas réfléchir à la voie du milieu et prendre le meilleur des 2 mondes ? Pourquoi ne pas imaginer un véhicule capacitaire et sécurisant qui s’envisage comme un vélo ? Ne pouvons-nous pas faire ce premier pas vers un véhicule de taille intermédiaire ? Quelles seraient les caractéristiques principales de cette nouvelle catégorie de véhicule ?
Engager une évolution sérieuse vers un moyen de transport moins émissif passe physiquement par la réduction des masses et des vitesses. Réduire son impact, c’est également changer l’usage et remettre en question la propriété. Pourquoi ne pas mutualiser les assets pour ne pas multiplier les véhicules à l’arrêt et finalement réduire les coûts pour chacun ?
Bienvenu dans le monde du véhicule bas carbone !
L’analyse du cycle de vie
La conception d’un véhicule bas carbone doit être une réflexion en profondeur sur les différentes phases de vie du véhicule. Il est nécessaire de réfléchir aux matières utilisées et la manière de les mettre en œuvre. Nous regardons ensuite la vie du produit et comment nous allons pouvoir maximiser son usage et prévoir un système de maintenance. Enfin, c’est anticiper la fin de vie et prévoir à l’avance ce que vont devenir les pièces changées ou les véhicules considérés comme inutilisables.
Il est nécessaire de rappeler qu’un véhicule 0g de CO2/km n’existe pas. Il n’est pas honnête intellectuellement de ne pas prendre en compte son empreinte globale et d’occulter volontairement ou involontairement les phases les plus émissives.

Des véhicules au juste besoin
Le véhicule intermédiaire fait le lien entre le vélo cargo et la petite voiture. Il répond à tous ces besoins de transport de faible ou moyenne masse (100 à 400 kg) et sur de courtes à moyennes distances (10 à 50 km). Ces véhicules se veulent légers et roulent à une vitesse suffisante pour être homogènes au trafic routier mais suffisamment lents pour consommer peu d’énergie. Leur définition est modulaire afin d’adresser différents marchés et différents usages et ramener de la cohérence entre le besoin et le véhicule. Nous passons d’un véhicule à tout faire à un écosystème de véhicules adaptés à un usage donné.
Les matériaux
L’industrie automobile est consommatrice d’énormément de matières premières : métaux, plastiques, verre… Nous voyons aujourd’hui les limites du modèle et l’augmentation chaque année du parc automobile.
L’idée du rétrofit est séduisante mais a du mal à s’imposer.
Le gisement actuel de véhicules et de matière en fin de vie constituera la source de matière première pour les véhicules de demain. Cette source sera complétée par des matières de surface (agro-sourcing) et si possible produites au plus proches du lieu d’utilisation des véhicules.
L’efficience
Un système de motorisation peu gourmand en énergie paraît évidement une des variables de l’équation. La motorisation électrique constitue en soi une opportunité de rendement pour un certain nombre d’usages.
Une autre piste à explorer est la production d’énergie embarquée. Le freinage régénératif permet par exemple d’utiliser l’énergie dissipée lors des décélérations et des freinages afin de la transformer en électricité. Les véhicules dits actifs (équipés d’un pédalier, d’un maindalier…) permettent à l’utilisateur de contribuer (de façon plus ou moins significative) à la production de l’énergie nécessaire pour se déplacer.
C’est une diversité de solutions techniques et d’usages qui peuvent cohabiter pour optimiser les performances de consommation des véhicules.

Proposer un service et pas uniquement un véhicule (économie de la fonctionnalité)
Nous avons le réflexe culturel d’envisager une automobile comme un bien de consommation personnel ou partagé à l’échelle du foyer. Comment pouvons-nous revoir ce modèle pour qu’il réponde à notre besoin tout en baissant les coûts et les émissions et en maintenant un bon niveau de disponibilité ?
Le besoin réside dans un déplacement de personnes ou de biens avec des contraintes temporels donnés : devons-nous forcément posséder notre véhicule ?
De nouveaux business modèles ont déjà vus le jour pour proposer des services de transport comme l’autopartage et la location très courte durée. Ces services, appuyés sur le digital, permettent d’être calibrés au plus proche du besoin.
Repenser notre organisation
Optimiser les transports et diminuer son impact passera par des organisations nouvelles, notamment pour les professionnels. En effet, les flux logistiques représentent un peu moins de la moitié des émissions sur des centres urbains. La containerisation en est un exemple : les tournées peuvent être préparées à l’avance sur des zones éloignées des centres villes. Les containers sont ensuite déposés par un gros porteur en une fois et une nuée de plus petits véhicules viennent les chercher.
Créer de la valeur en France
Maintenir de la production industrielle en France, dans des territoires plus ruraux, c’est créer de la valeur locale. La délocalisation de l’industrie pour des questions de rentabilité pure montre actuellement ses limites et hypothèque notre indépendance, tout comme la conservation des savoir-faire. Le made in France est donc obligatoire, tant sur l’aspect social qu’environnemental.
À l’heure où les défis climatiques, économiques et urbains imposent une transformation profonde de notre mobilité, les véhicules intermédiaires apparaissent comme une réponse à la fois réaliste et ambitieuse. Ces solutions sobres et efficientes ouvrent une voie nouvelle, plus respectueuse de l’environnement et mieux adaptée aux usages du quotidien. Leur développement repose désormais sur notre capacité collective à repenser les infrastructures, à faire évoluer les réglementations et à accompagner les usagers vers de nouveaux réflexes de déplacement. L’avenir de la mobilité ne se résume pas à l’électrification des modèles existants, il passe aussi par l’innovation de rupture, celle qui redonne du sens au mouvement, sans compromis entre performance, utilité et sobriété.
Crédit photos : Salon des véhicules intermédiaires 2024 à Laval – Julien Sales